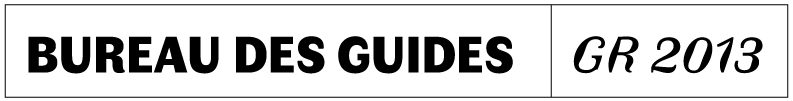Hendrik Sturm (†2023)
Artiste promeneur de la ville invisible
Hendrik Sturm est artiste marcheur. Originaire de Düsseldorf, il vit à Marseille depuis 1994.
Après avoir mené de front, entre la France et l’Allemagne, une formation aux Beaux-Arts et une thèse en neurobiologie, Hendrik Sturm enseigne aujourd’hui à l’école des Beaux-Arts de Toulon, et pratique son art de la marche un peu partout en France, à Marseille ou Paris, souvent en zone périurbaine, mais également en centre-ville ou en milieu rural.
« Je ne marche pas comme le fou voyageur, je ne recherche pas l’épuisement, même si ça peut arriver. Parfois, on n’a plus envie de s’arrêter de marcher, alors c’est la nuit qui nous arrête. Mais il est aussi possible de faire une marche significative qui ne dure que cinq minutes. Dans mon cas, la marche est aussi une méthode d’étude. Je la pratique moins comme pratique spirituelle que comme outil de découverte, méthodologie d’enquête – lecture de traces. »
Lire un article sur Hendrik par la revue Strabic
Artiste-marcheur co-initiateur du GR2013, Hendrik nous a quitté le 15 août dernier. Le samedi 9 décembre 2023, nous irons marcher Dans les pas d’Hendrik Sturm sur le plateau de l’Arbois.

Entretien avec Hendrik Sturm
Comment en es-tu venu à faire de la marche le centre de ton activité artistique?
On prend la marche au sérieux dans des moments biographiques importants. Souvent, au départ, il y a un problème – pas forcément grave ou insoluble, mais un contexte problématique. Au moment donné, un détachement a lieu. On se met en marche par nécessité. Un ami m’a récemment dit qu’il ne pouvait pas s’empêcher de marcher, que c’était compulsif chez lui, pour faire le vide, pour se débarrasser de quelque chose. Il ne tient littéralement pas en place. Dans mon cas, c’était une période où je me sentais dans un certain vide – professionnel et institutionnel – et en même temps, dans une certaine liberté aussi. C’était la fin de ma thèse en neurobiologie, sans suite. Marcher, c’est toujours un peu larguer les amarres. Je ne marche pas comme le fou voyageur, je ne recherche pas l’épuisement, même si ça peut arriver. Parfois, on n’a plus envie de s’arrêter de marcher, alors c’est la nuit qui nous arrête. Mais il est aussi possible de faire une marche significative qui ne dure que cinq minutes.
Dans mon cas, la marche est aussi une méthode d’étude. Je la pratique moins comme pratique spirituelle que comme outil de découverte, méthodologie d’enquête – lecture de traces.
Ma thèse de neurobiologie portait sur des signaux bioélectriques liés à la contraction du poignet chez l’homme. J’enregistrais donc des potentiels d’action, des centaines de milliers de d’impulsions électriques dans deux muscles. Dans cette masse colossale de données, tu recherches les régularités, les structures. A un autre moment, pendant un an, au moyen d’un microscope électronique, je me suis promené dans les muscles d’un ver de terre. Une surface de moins d’un millimètre carré, grossie 20 000 fois, devient plus grande qu’un terrain de tennis. On est dans une masse de données dans laquelle il faut s’orienter, se repérer, qu’il faut cartographier.
Le territoire de Marseille a donné naissance, depuis une ou deux décennies, à un développement singulier de la marche urbaine comme pratique artistique. Peut-on revenir sur quelques personnes clefs de cette pratique à Marseille ?
Christine Breton, une conservateur du patrimoine atypique, a été l’une des pionnières de cette pratique à Marseille (à condition de faire l’abstraction de l’histoire plus que centenaire des « excursionnistes marseillais » et autres « buveurs d’air » plus récent comme ceux de l’association AMIEU, Atelier marseillais d’initiatives en écologie urbaine.) Dans son cas, la marche me semble clairement liée avec le fait d’être en dehors de l’institution, ou en tout cas dans une relation de distance avec elle. Elle a commencé, me semble-t-il, après son départ de l’école des Beaux-Arts de Nîmes. Elle m’a beaucoup influencé, en particulier dans sa démarche d’ouverture de la pratique artistique vers le monde industriel. Grâce à elle, j’ai fait un stage de 6 mois dans une usine de céramique.
« Je n’ai plus besoin de musée : il est là, dehors, partout. »
A Marseille, depuis la fin des années 1980, elle a joué un rôle important dans l’art contemporain à ce qui était alors l’Office de la culture. Elle s’occupait entre autres d’une revue qui s’appelait « la Galerie de mer », ce fameux tunnel qui passe sous Marseille depuis les mines de Gardanne – mais qui est une bonne métaphore de son travail dans la culture à Marseille, et en particulier d’un programme de résidences d’artistes dont elle s’occupait alors, et qui était, comme la galerie, sur le territoire, entre le visible et l’invisible. Cette galerie de la mer elle-même était un peu entre le rêve et la réalité. C’est un monument de premier ordre du patrimoine industriel, à la limite du légendaire. Je crois qu’elle a commencé à faire des marches comme « passeur », auprès des artistes qu’elle accueillait dans son programme de résidence. En tant que conservateur du patrimoine, elle ne voulait pas faire de collection, elle défendait et défend toujours l’idée du « patrimoine intégré » dans les mémoires, les pratiques. Il s’agissait, là aussi, de sortir du musée et de l’institution.
Il y a ensuite Laurent Malone, artiste et photographe du groupe Stalker, qui a marché à Manhattan avec Dennis Adams…
Oui, Laurent Malone a été mon « accoucheur ». Sans avoir lui-même une réelle pratique de la marche, il m’a fait comprendre que cela pouvait être une vraie activité, valable et sérieuse. Il m’a fait voir la marche comme champ d’expression. A l’occasion d’une grande exposition de Laurent Malone en 2000 au Frac (LMX), il proposait une activité hors les murs, avec 3 marches. Il a sous-traité les marches, et a fait appel pour l’une à Christine Breton, et pour les deux autres à Elisabeth Apprill et moi-même. Elisabeth Apprill est spécialisée en géographie urbaine, et spécialisée sur l’Afrique. J’ai pris beaucoup de plaisir à explorer le terrain avec Elisabeth, qui est très armée conceptuellement et méthodologiquement.
Tu as assisté aux débuts de Nicolas Mémain, conférencier ambulant spécialisé dans l’architecture de la deuxième moitié du 20e siècle ?
Oui, j’ai une relation importante avec Nicolas Mémain, qui est pour moi un interprète des formes enchanteur. Je l’ai connu à l’occasion d’une exposition « Jeunes talents », dont il faisait partie au Château de Servières. Comme je commençais à être identifié dans mon champ, cela a du coup être encourageant pour lui, une incitation à développer lui aussi des marches publiques – et à prendre le territoire comme matière, ou comme œuvre.
Quels liens as-tu avec le collectif SAFI, qui travaille beaucoup sur le végétal, dans les quartiers nord de Marseille ?
Dalila Ladjal, graphiste, et Stéphane Brisset, sculpteur, du collectif SAFI, sont partis de la matière végétale, en la prenant aussi comme ressource nutritive. Ils sont rentrés dans le territoire par la récolte. Et ils produisent des traces – confiture, cabanes, cartes. On s’est rencontrés au festival Art des lieux, organisé par l’association Arènes au début des années 2000, à la première édition, à Sainte-Marthe. Ce festival a eu un important rôle fédérateur – il y avait là, entre autres, Nicolas Mémain, Dalila et Stéphane, Olivier Bedu.
Qui d’autre ?
Il y a Matthias Poisson, qui a quant à lui une formation initiale de designer. Séduit par des rencontres avec des chorégraphes, il a développé des « promenades littorales » dans des villes de la Méditerranée – dont Marseille et Beyrouth. Il a suivi une formation en danse avec Mathilde Monnier, développant en parallèle marche, dessin, danse et scénographie. C’est un performer, dont les activités tournent autour de la marche. Enfin, je travaille beaucoup avec Marc Quer, qui est en ce moment mon principal collaborateur. Après un début en études d’architecture, il a fait les Beaux-Arts, où il a mené une activité de sculpteur-installateur, dans un travail qui manifeste une position anti-institutionnelle, une grande volonté de liberté. Ses installations sont inspirées par des traces très modestes du territoire. Il a parcouru Marseille la nuit comme personne. Il a une grande connaissance empirique des lieux. Collectionneur depuis toujours, il investit depuis quelques années le travail de la marche. Mais dans les dernières années, j’ai rencontré au moins une trentaine de personnes à Marseille qui développent un travail artistique autour de la marche. L’histoire de cette mise en marche reste à écrire.
La marche, chez toi, renvoie directement à un objet: l’objet urbain, ou périurbain.
Oui, mon objet est la ville, ou les formes urbaines (puisque certains affirment que la ville en tant que telle est un peu désintégrée aujourd’hui). La ville ou les formes urbaines, c’est le lieu où l’humain s’exprime le plus, c’est l’objet humain le plus complexe. Un de mes plaisirs singuliers, c’est plus précisément l’interaction entre le naturel et l’artefact. Au-dessus de chez moi, commence la garrigue des massifs des calanques, et nous avons vu à l’instant les traces d’un sanglier près de mon compost, ainsi que les restes d’un four à chaux artisanal en pierre. Quelqu’un a fabriqué ici son propre mortier, à partir des ressources naturelles immédiates – calcaire disponible, bois pour le feu, et pierres pour le four. Cela fait pour moi écho avec l’engouement actuel pour le jardin – lieu privilégié de la relation entre nature et monde urbain. Ce four à chaux renvoie aussi à la connaissance géologique du maçon, car n’importe quel calcaire ne se prête pas à la fabrication de la chaux. Ces bribes de «science vernaculaire» nous rappellent au fait qu’il n’y a pas d’étanchéité entre la culture vernaculaire et la culture savante. Dans ma pratique, je cherche toujours à rendre perméable cette frontière entre les deux.
« Un de mes plaisirs singuliers, c’est l’interaction entre le naturel et l’artefact. »
Mon objet est donc la ville, ou le territoire, c’est-à-dire un objet engagé par l’homme – c’est l’appropriation humaine qui m’intéresse. Au départ, j’ai commencé par marcher beaucoup dans le périurbain, la ville peu dense. Peut-être parce que c’est plus facile d’en lire la morphogenèse. Les zones qui ont cent ou deux cents ans sont plus faciles à comprendre que les palimpsestes de deux mille ans, comme le centre de Marseille peut en offrir. A Marseille, dans l’espace périurbain, on profite du charme des friches, lié à la déprise industrielle. Ensuite, ça a été le centre-ville, et maintenant je m’intéresse plus au rural, où l’on retrouve de nombreuses figures du périurbain. Ça rejoint l’anthropologie de l’espace.
Si la marche est un art, l’ «œuvre» serait pourtant plutôt dans le territoire lui-même, dont elle révèle la qualité, que dans les productions qui en résultent?
Evidemment, la ville est une œuvre, tout comme d’autres formes territoriales. On est parfois ébloui par la beauté et la justesse des formes de ces œuvres collectives. Mais notre travail d’artiste consiste plutôt à tirer profit des accidents, des tensions, des choses ni pensées, ni voulues, qui ne font pas œuvre, en tout cas pas dans ce sens-là. L’inconscient de la ville, en quelque sorte. On essaye de prendre au sérieux toutes les choses qui ne figurent pas quand tu regardes les documents des faiseurs de ville. Pour moi, l’acte artistique réside dans l’acte interprétatif dont la ville est l’objet. Lire la ville, c’est pour moi avoir un regard clinique, scrutateur, qui permet d’interpréter des traces, comme signes de forces (ou de logiques) à l’œuvre. L’historien Carlo Ginzburg a bien décrit cette forme d’approche au 19e siècle, qui est contemporaine du développement de la littérature policière (Poe, Conan Doyle) et concomitant du développement de la psychanalyse. Dans le domaine de l’histoire de l’art et de la peinture en particulier, on se met à développer de nouvelles techniques d’authentification, en se concentrant sur ce qui était jusque alors considéré comme des détails secondaires – Ginzburg appelle cela le « paradigme de l’indice », dont fait pour moi partie l’art de la marche. D’autres fondements théoriques évidents de ma pratique sont à chercher dans la «psychogéographie» des situationnistes. Mais cela se conjugue très bien avec l’idée des traces. J’aime en général ce basculement entre conscient et inconscient, entre volontaire et accidentel, et on retrouve tout ça dans le statut d’une trace. Dans sa forme littérale, la trace est la marque physique d’un contact direct, mais la chose même a disparu. Quelque chose de matériel subsiste d’une absence.
Marseille est donc une ville pleine de traces?
Oui, même si l’on peut trouver des traces partout. Au début de l’été, j’étais dans la banlieue parisienne, dans l’Essonne. C’est vrai que là-bas les formes urbaines sont peut-être plus pensées qu’ici, il y a sans doute là-bas une culture plus développée de la concertation et de la gouvernance. Mais même là, il y a plein de choses qui échappent, des choses pas vues, pas pensées. Le mythe dit que Marseille est une ville sans monument, où l’on fait disparaître les traces du passé. C’est probablement vrai, par exemple par rapport à une ville comme Nîmes, où l’Antiquité est très présente, jusqu’à l’intérieur des maisons de centre ville. C’est évidemment plus difficile de lire une ville comme Marseille, où beaucoup de traces ont disparu. Mais sur une échelle de temps plus courte, de l’ordre du demi-siècle, marquée par le déclin de l’activité industrielle et d’une planification raisonnée, il y a peut-être à Marseille plus qu’ailleurs davantage de traces du passé récent. Et cela donne plus de prise à l’interprétation. Marseille est une des villes les plus anciennes d’Europe. Mais de toute façon, l’art de la marche se situe entre le visible et l’invisible. Que tu produises ou non des formes matérielles, tu produis de l’invisible, de l’intelligible.
Pourrais-tu nous donner des exemples de traces?
Face à nous, la colline de Rouvière laisse apparaître une falaise rocheuse laissée par une carrière abandonnée, qui était en activité jusque dans les années 1950-1960. Elle a été investie après sa désaffection pour y faire de la ville. Derrière, on aperçoit les arbres calcinés de l’incendie du 22 juillet 2009. Les traces peuvent rendre compte de processus longs – comme la carrière – ou très rapides – comme l’incendie. La colline de Rouvière laisse aussi apparaître les résultats d’un temps intermédiaire: celui de la construction. Les bâtiments spectaculaires de Rouvière et Super Rouvière sont une partie de «Super Marseille» (qui compte aussi Valmante et Valmante –Michelet, formant un ensemble de 4000 logements). Au départ, le bâtiment du haut n’était pas prévu; mais suite au succès du premier (lié à l’arrivé des rapatriés d’Algérie), on a copié-collé un deuxième bâtiment. Comme il y a 90 m de dénivelé entre les deux, on a mis en place un système de bus intérieur, dans ce qui est la plus grande copropriété d’Europe. Parfois la documentation te permet de voir des traces, que tu n’aurais pas vu sans cela. Dans une papeterie de Rouvière, j’ai trouvé des cartes postales des premières années de la cité. L’une d’elles montre une piscine creusée, et arrêtée en cours de route, suite à une faillite du constructeur. Lorsque l’hôpital Michel Lévy au centre-ville a été démoli, Bernard Tapie étant alors élu de l’arrondissement, a fait remplir ce trou avec les gravas du chantier.
Partages-tu l’idée de Smithson qui «revendique pour son art les mines abandonnées et les carrières», ces espaces ni vraiment urbains, ni vierges?
Oui, tout à fait; on est nombreux, comme artistes, à se placer au point de bascule du naturel et de l’artificiel. Il y a là un grand courant, dans le fait de regarder les formes, d’être attentif aux formes, sans savoir si c’est fait par un homme ou si c’est créé naturellement. Ceci dit, cet intérêt pour les «formes multiples» ne date pas d’hier; il est par exemple évident dans la cabinets de curiosité, qui présentent indistinctement des objets mécaniques ou naturels. Smithson s’inscrit dans un courant qui a lui-même 500 ans, et peut-être même davantage!
Quand j’étais encore à Düsseldorf, j’ai étudié chez l’artiste Tony Cragg, un sculpteur qui travaille le marbre, le bois, le bronze, la céramique, le plâtre. Il crée des formes, mais il y a un trouble: on ne sait pas si elles sont naturelles ou faites par l’homme. Est-ce un fossile ou une œuvre humaine? Fontcuberta, à Digne, a poussé cette idée jusqu’à faire de l’histoire montée, de la « fausse paléontologie ». Mais Smithson n’a pas besoin de fausses histoires, quand il met de la terre sur le toit d’une cabane, jusqu’à ce qu’elle s’effondre («Partially buried woodshed, 1970, Kent, Ohio). Tout ceci renvoie à une permanence de l’histoire de la sculpture: ce dialogue entre l’intention d’un artiste et la matière, qui suit ses propres règles. Michel-Ange joue aussi sur l’aspect brut de la pierre, même si c’est pour faire ressortir la perfection de sa statue – alors que dans la cabane de Smithson, au contraire, l’intention humaine s’abolit dans la matérialité.
Les cabinets de curiosité constituent donc une autre fondation théorique de mon travail. Quand je marche en ville, je m’amuse à prendre la ville comme une chambre de curiosité, une collection de merveilles. Sauf que là, il n’y a pas de collectionneur, pas de commissaire, qui a conçu le bric-à-brac, qui a mélangé artefacts et objets naturels, à des fins d’étonnement et d’instruction. Le territoire de la ville n’est pas arrangé par un collectionneur, mais il me procure le même type de plaisir. Je n’ai plus besoin de musée: il est là, dehors, partout. Mon regard instruit la ville comme un cabinet de curiosité à ciel ouvert.
Vas-tu jusqu’à revendiquer l’idée de Kant selon qui, dans l’acte artistique, c’est d’une certaine façon la nature qui est à l’œuvre?
C’est en effet l’idée qui sous-tend le cabinet de curiosités; la natura naturans (la nature comme force productrice de formes) qui se manifeste aussi dans le travail de l’artiste. Cela rejoint la question de la morphogenèse: cette manière de voir les phénomènes au-delà des disciplines spécifiques. L’idée de morphogenèse s’applique à de très nombreux domaines – on parle de morphogenèse des villes, de géomorphogenèse, d’embryogenèse. Certains prétendent qu’il y a des logiques semblables qui sont à l’œuvre. C’est un terrain tentant, mais glissant! Le principal danger serait de suggérer des processus simples, de rater ou de sous-estimer leur complexité. Quand tu prends des photos aériennes de Montpellier, que tu regardes 50 ans en accéléré, tu as littéralement l’impression que «ça a poussé»; et ça ressemble peut-être, par certains traits, à la croissance de micro-organismes. La métaphore des rhizomes est valable. Mais il faut garder son sens critique. Cette métaphore a été utilisée dans la sociologie de la ville, mais tout cela a aussi été un gros chantier en cybernétique. Au cours des célèbres « Macy Conferences », a été développée l’idée du bionique (imitation du vivant par le design industriel), et aussi dans l’autre sens : des réflexions d’ingénieurs ont aidé à inspirer la thérapie systémique. La psychogéographie propose une approche romantique, sensible, de la relation au paysage. On se met dans cette posture en se détachant des déplacements fonctionnels ; telle est du moins la consigne de Guy Debord dans sa théorie de la dérive. Il s’agit de créer des temps de parenthèse. Ce qui est amusant, c’est que la psychogéographie gagne du sérieux scientifique, alors même qu’elle avait été conçue au départ délibérément comme un mouvement critique anti-institutionnel. Les architectes et chercheurs d’un laboratoire de Grenoble, le CRESSON, ont récemment fondé un réseau international de science des ambiances urbaines. Ils étudient les réactions des individus et des groupes à certaines modalités sensorielles de la ville – dans l’espace sonore, olfactif, thermique. Leur travail, qui peut aussi déboucher sur des choses très pratiques (des « ingénieurs ambianceurs ») est tout à fait dans la lignée de la psychogéographie.
Partages-tu l’idée de Smithson, fondatrice du land art, selon laquelle désormais, dans le domaine de l’art, c’est le territoire, l’espace, le site qui est premier ?
Oui, même si je suis très sensible aux mots, qui ne sont pas équivalents. « Territoire » renvoie à une réalité en partie construite par l’homme. « Lieu » est un espace géographique, mais pour laquelle la notion d’étendue n’est pas pertinente. Le lieu est plutôt comme un point. C’est un espace nommé, par lequel on crée une identité qui se détache du fond. Le même territoire physique peut accueillir un grand nombre de « lieux », à différentes échelles, pour différents interlocuteurs. C’est là l’une des facettes de mon travail, qui consiste à mettre en évidence la superposition de lieux hétéroclites. C’est cela qui me tient vivant, et qui évite à mon regard de se figer. Avant-hier, j’ai découvert sur la colline Saint-Joseph une information intéressante grâce à un collectif qui s’appelle SudWall, et qui s’intéresse aux fortifications allemandes de la côte méditerranéenne. Ils superposent les documents d’archives avec Google Earth, et c’est comme ça que j’ai appris que sous la chapelle qui est en face de nous, il y a un réseau de tunnels, avec trois entrées. Cette colline, qui est un lieu ancien de pèlerinage, et sur laquelle on a construit au 19e cette chapelle, est aussi un ancien lieu militaire.
Mais le primat de l’espace, oui, je partage cette idée. C’est dans cette optique que « crée » des lieux, un peu comme un anatomiste détache des objets. D’ailleurs, il y a plusieurs « lieux » dans un organisme. Dans un muscle de vers de terre, il y a évidemment beaucoup de cellules contractiles, mais aussi des tissus qui relient, et aussi ces objets minuscules mais essentiels que sont les nerfs. Dans la ville aussi, il y a des éléments de l’espace dont l’emprise spatiale n’est pas en adéquation avec l’importance. Chez moi, l’ancienne arrivée d’eau unique de la ville était un tuyau de moins d’un centimètre de diamètre.
Pourquoi ne pas explorer davantage cette métaphore de la ville comme organisme ?
Ma réticence est d’’abord pratique : on est dans une ville où un urbaniste peut aussi être un médecin dans la vie civile, et je me méfie, dans le domaine de la ville, des fausses « évidences scientifiques », qui réduisent les problèmes, et permettent parfois d’éviter un vrai travail de concertation. Mais c’est vrai qu’il y a par exemple une biochimie de la ville, et qu’il faut l’aborder, sans métaphore.
L’analogie fonctionnelle qu’on peut trouver entre une ville et un organisme ne mérite-t-elle pas d’être approfondie ?
Oui, sans doute, peut-être en utilisant le concept de « symbiose ». Au niveau cellulaire d’ailleurs il y a des indices d’une symbiose historique: dans chaque cellule vivante à noyau, il y a des mitochondries. Ces mitochondries étaient, il y a 2 milliards d’année, des bactéries symbiotiques qui se sont intégrées à la cellule.
Wildproject, août 2010