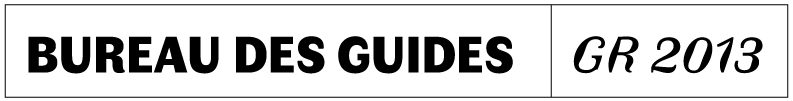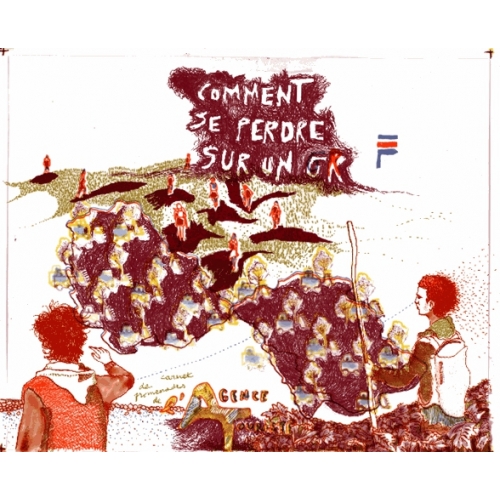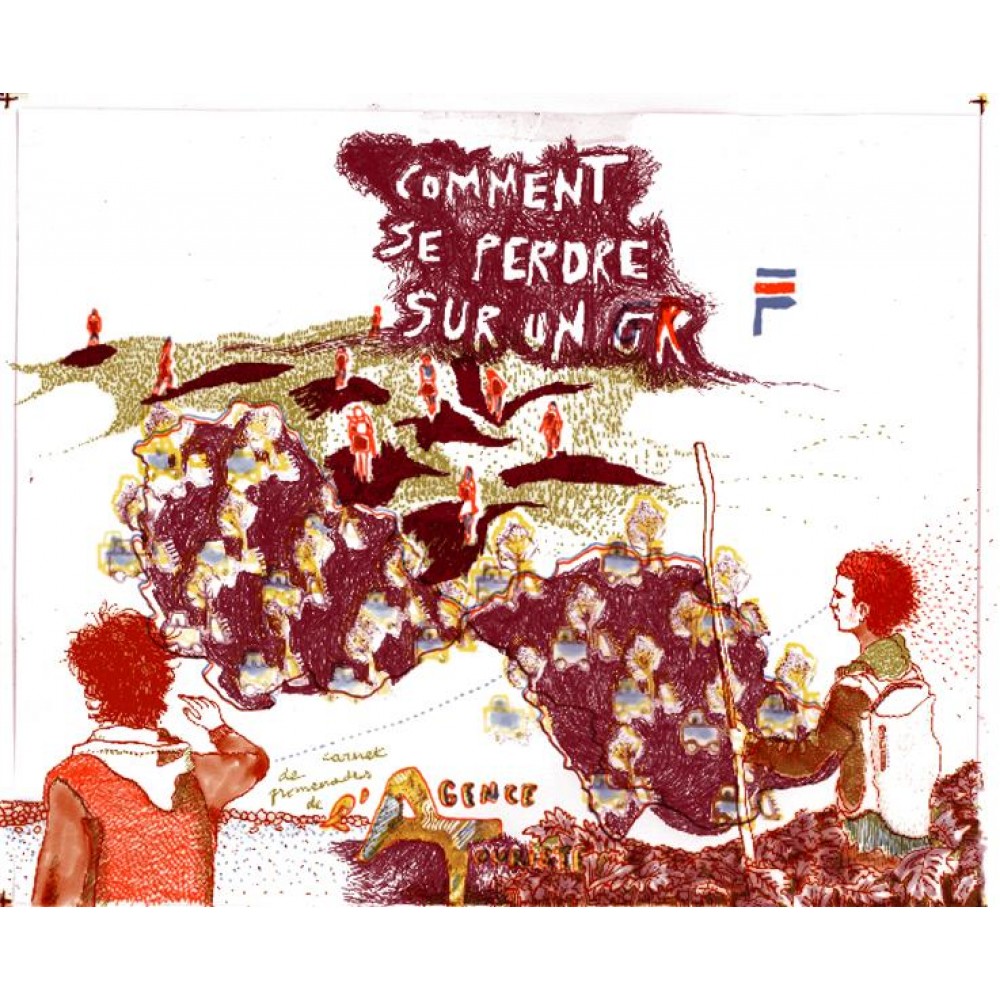365 km en 13 jours en solitaire
L’intégralité du GR2013 en solo en 13 jours.
La nouvelle présidente du comité départemental de randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône, Marianne Clarté, a parcouru l’intégralité du GR2013 en solo en 13 jours. Entre anecdotes personnelles, diagnostic territorial, confession de randonneuse et analyse d’itinéraire, l’ancienne élue écologiste et militante partage ici sa façon de marcher.
C’était en 2013, je m’étais cassé le bras, j’étais arrêtée, j’avais donc du temps devant moi. Je suis une marcheuse, j’avais entendu parler de ce nouveau sentier. Je me suis dit : « je vais découvrir le territoire en parcourant le GR2013 ». J’étais alors vice-présidente de l’Agam (car élue à la ville de Marseille) et mieux connaître l’aire métropolitaine m’intéressait aussi à ce titre.
Comment avez-vous parcouru l’itinéraire ?
Je voulais le faire toute seule, en entier et de façon suivie. Ayant une famille, je voulais rentrer chez moi chaque soir, en utilisant les transports en commun. On peut donc dire que je l’ai parcouru en « itinérance intermittente ». J’ai commencé par la boucle de Marseille puis j’ai continué à partir de Saint-Marcel vers Aubagne et Aix ; et ensuite la boucle de Berre. J’ai bien souvent fait deux étapes en une, donc une moyenne de 30-40 km de marche par jour; j’ai ainsi parcouru le grand 8 en treize jours, en deux à trois séquences. J’ai fini en décembre 2013, avec une randonnée de Salon à Aix-TGV. Je suis sortie de la gare, il neigeait ! Puis un mistral glacial s’est levé. Pour pique-niquer, cette fois là, je suis entrée dans un bistrot de la Fare-les-Oliviers ; je peux vous dire qu’on m’a regardée avec des yeux ébahis. Et le lendemain, il gelait à pierre fendre à Velaux, ce qui m’a valu une glissade monstre sur une plaque de verglas !
J’ai passé une seule nuit « dehors ». Je m’étais trompée dans mes distances, je voulais aller plus loin, je suis arrivée trop tard à Istres, plus moyen de rentrer à Marseille. Je me suis retrouvée dans un bar où d’aimables messieurs m’ont proposé de m’emmener à la gare de Miramas ; mais ils avaient trop bu pour que j’accepte. J’ai donc appelé un petit hôtel une étoile, qui m’a dit qu’il n’avait plus de place ; j’ai insisté en faisant valoir que je parcourais le GR2013, et là les portes se sont ouvertes : « Ah bon ! Mais j’ai de la place alors ». En fait l’hôtel était quasiment vide. J’avais faim comme après une journée de marche, il m’a indiqué un restaurant où on m’a décongelé un dos de cabillaud.
Et aussi une fois, entre Plan d’Aups et Auriol, où il n’y a guère de transport en commun, j’ai fait du stop – ça se passe bien en général avec un sac à dos.
Dans le TGV d’Aix à Marseille, je dois avouer que je n’ai jamais payé le billet. Les contrôleurs me disaient « Ah, vous faites le GR2013 ! Et puis vous avez un beau sac à dos… Allez, c’est bon, circulez… »

Vous connaissiez déjà bien les Bouches-du-Rhône. Qu’avez-vous découvert ?
J’ai découvert des tas d’endroits. Je n’avais pas pris la mesure de la place de l’eau à Marseille – je pense en particulier à un beau passage en bord d’Huveaune entre la Valentine et Saint-Marcel, ou encore au vallon Dol, le réservoir d’eau dans le massif de l’Etoile. J’ai découvert tous ces quartiers entre Saint-Marcel et Mazargues, avec le canal d’irrigation de beaux jardins partagés. Et dommage, les canaux ont été recouverts dans le 12e arrondissement, mais pour le plaisir des promeneurs et joggers. Dans un genre plus industriel, j’ai énormément aimé la grande passerelle au-dessus de la gare de triage du Canet.
JE ME FAISAIS ABORDER PAR DE NOMBREUX MESSIEURS, SANS COMPRENDRE POURQUOI… PUIS J’AI LU LE TOPOGUIDE ET J’AI COMPRIS
J’ai découvert le village de Grans, que je trouve magnifique, et de beaux endroits sauvages, comme le vallon entre Châteauneuf-les-Martigues et Martigues : si près des grandes zones industrielles et pourtant si silencieux ; mais il a brûlé l’été dernier.
J’ai découvert aussi un drôle de bout de route et de petit bois, au nord de la gare Aix-TGV, « le chemin des Dames » disons… Je me faisais aborder par de nombreux messieurs, sans comprendre pourquoi… puis j’ai lu le topoguide et j’ai compris [rires] !
J’ai pique-niqué dans des endroits parfois bucoliques (comme la corniche du mont Carpiagne au-dessus de la vallée de l’Huveaune, entre Saint-Marcel et Aubagne, ou comme la plage du Ranquet en bordure de l’étang de Berre, un peu avant Istres), mais aussi dans des endroits plus improbables, comme le McDo de Martigues (car je mourais de soif) ou encore à Plan-de-Campagne !
J’ai même découvert un très bel endroit tout près de chez moi : la traverse piétonne Picasso, qui relie le château d’eau au Prado. J’ai aussi aimé la séquence entre le parc Borély et le MAC, dont je me suis resservie récemment pour créer une boucle de 12 km de marche nordique. Et au détour des chemins, que de beaux arbres, on pourrait sans doute en faire un livre à eux seuls.

Qu’avez-vous moins aimé ?
Le pavillonnaire ! J’aime bien l’idée de marcher dans les zones commerciales, ou a proximité des usines, car tôt ça fait partie de la vie. Mais j’ai beaucoup plus de mal avec les zones pavillonnaires, qu’on traverse assez souvent (elles sont nombreuses dans le département) et que je trouve particulièrement tristes. Le pavillonnaire pour moi, c’est d’abord un enfermement, mais c’est aussi une aberration urbanistique, ça dévore du territoire, ça coûte cher en termes de réseaux et de transport. Socialement et écologiquement, c’est tellement moins bien que les petits immeubles de quatre étages au milieu de jardins et parcs partagés !
JE ME SOUVIENS D’UN MOMENT ENNUYEUX : TROP DE GOUDRON ENTRE MEYREUIL ET AIX.
Je me souviens d’un moment ennuyeux : trop de goudron entre Meyreuil et Aix. De temps en temps, j’avais le sentiment qu’on aurait pu passer sur le chemin d’à côté (pour lequel on n’avait peut-être pas encore obtenu l’autorisation de passage du propriétaire). Mais tout cela fait partie des améliorations de l’itinéraire, que nous sommes en train de mettre en œuvre. C’est une situation assez classique dans les GR ; je participais tout récemment à l’inauguration du GR42 (Balcons du Rhône), qui n’a pas de vocation métropolitaine ou urbaine, et qui comporte pourtant bien trop de passages goudronnés du coté d’Arles (propriétaires, publics ou privés, un petit effort pour que la randonnée soit un bel attrait touristique pour notre département).
Je garde en mémoire le départ de Plan d’Aups, assez dur en termes d’entrée de ville.
Avez-vous fait beaucoup de rencontres ?
Quand on parcourt le GR2013, on croise évidemment beaucoup d’habitants, mais je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer beaucoup de gens avec qui parler. Je me souviens qu’en arrivant au Plan d’Aou, je buvais à la pipette dans la montée, lorsque des gamins d’une dizaine d’années sont venus vers moi et m’ont dit en souriant « Madame, comment vous boyez? » Il m’a fallu quelques temps pour comprendre qu’ils conjuguaient le verbe boire, mais c’était une rencontre sympathique !
Une fois, je suis passée à la Busserine un après-midi, il y avait du deal en cours ; j’ai compris que je devais changer de trottoir.
Une fois, au départ de la gare Aix-TGV, j’ai croisé un couple de randonneurs qui démarrait leur journée. « Allez, on y va » ; ils s’apprêtaient aux aussi à parcourir l’intégralité du GR2013.
Je n’ai jamais eu peur en tout cas sur le GR2013 ; je dis ça car on me pose souvent la question.

L’expérience du GR2013 était-elle fondamentalement différente des autres GR ?
J’aime bien sentir et écouter mes pas. Il y a un rythme, je me cale dedans. Le GR2013 rend cela possible par la facilité du terrain – bien plus que les Calanques ou la montagne. J’aime la marche quand on peut allonger le pas, se caler sur des belles continuités, faire 30-40 km, parfois plus, sur des terrains assez plats, qui me permettent d’être dans mes pensées. Le cordon dunaire du Jaï permet ça, et également le plateau de Vitrolles, ma dernière étape entre Velaux et la gare d’Aix-TGV.
JE REGRETTE DE NE PAS AVOIR PU ORGANISER DE RANDONNÉE SUR LE GR2013 AVEC LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE.
Une des choses que j’ai aimées avec le GR2013, c’est qu’il est dans la vie, pas dans le pittoresque. Il est dans la vie quotidienne des gens, dans les lieux de travail, de production, de loisir, des lieux de culture aussi comme ce très beau moulin, à proximité d’Auriol, ces bastides dans le 9e arrondissement de Marseille…
J’ai apprécié le passage entre Plan-de-Campagne et les quartiers Nord, on passe par les hauteurs, au-dessus de l’autoroute, avec de grandes vues… un grand moment métropolitain. Ça montre ce que peut vouloir dire une métropole dans toutes ses composantes – infrastructures de transport, zones de production, habitats, nature…
Je regrette de ne pas avoir pu organiser de randonnée sur le GR2013 avec les élus du conseil municipal de Marseille et les collègues de l’Agam – je ne suis pas sûre que beaucoup l’aient pratiqué.
Entretien avec Marianne Clarté publié dans Marsactu